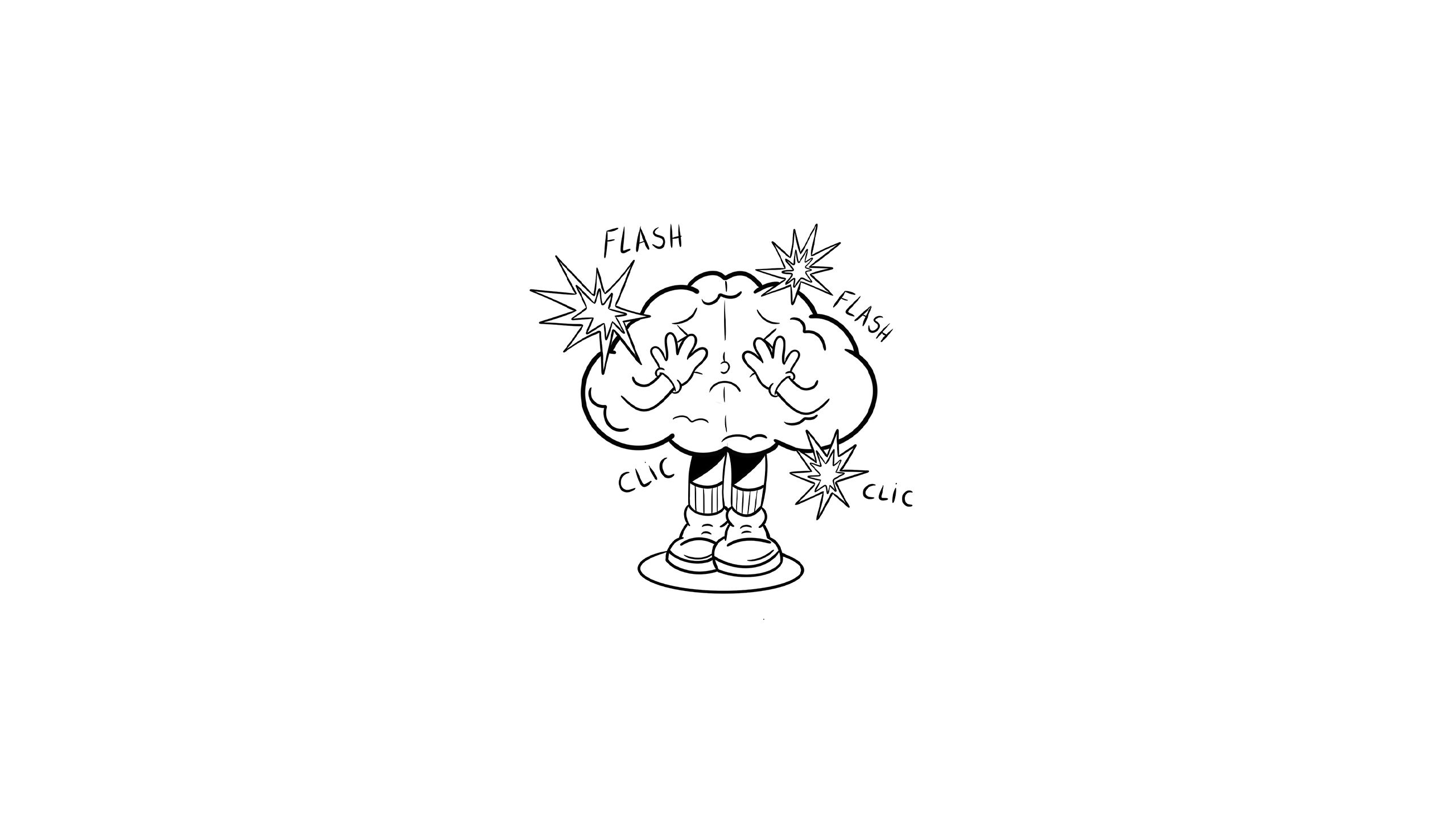
PRESSION MÉDIATIQUE
Couverture médiatique : une évolution exponentielle
XIXème siècle
L'apparition des premiers journaux sportifs
Dès le début du XIXe siècle, le sport trouve sa place dans les journaux imprimés. Des courses hippiques, des matchs de cricket ou de football sont couverts par la presse locale. Les premiers médias entièrement sportifs commencent à émerger comme "Le sport, journal des gens du monde", le premier journal entièrement consacré au sport en France, créé en 1854, selon Bertrand During, professeur à l'INSEP.
1896
Première édition des Jeux Olympiques modernes
Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, a renforcé l'intérêt porté au sport par les médias. Fervent défenseur des valeurs du sport et fin stratège, il a réussi à créer un retentissement international avec son évènement qui fût couvert par des médias du monde entier. Ces J.O. ont posé les bases d'un lien solide entre les médias et les évènements sportifs.
Les premiers sponsors font également leur apparition dans le monde du sport.
1920
Apparition de la radio
L‘arrivée de la radio marque un tournant majeur dans la couverture des évènements sportifs. Ce nouvel outil de communication permet à des millions de fans du monde entier de suivre les évènements en direct. L'engouement populaire autour du sport ne cesse de grandir, les attentes des fans s’accentuent.
1960-1980
Entrée en jeu de la télévision
C’est dans les années 1960, avec l’émergence de la télévision, que les retransmissions sportives se transforment en spectacles visuels. Les grands évènements sportifs deviennent alors des rendez-vous incontournables. Cette visibilité accrue conduit à une professionnalisation et à une commercialisation intensifiée du sport. Les sponsors se multiplient, deviennent des acteurs majeurs dans l’écosystème sportif et les droits de diffusion explosent.
Les athlètes sont désormais considérés comme des stars. De véritables idoles exposées à l’adulation comme à la critique.
1990
Apparition d'Internet
L’arrivée d’Internet permet aux fans d’avoir un accès instantané aux résultats, aux analyses et aux informations sur leurs équipes favorites. Plus rien ne peut échapper aux internautes et les forums en ligne ou sites dédiés leur donnent une voix directe pour exprimer leurs opinions.
XXIème siècle
Réseaux sociaux
et hyper-exposition
Depuis le début du XXIème siècle, la donne a totalement changé. Internet n'a cessé d'évoluer, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming en ligne ont fait basculer les athlètes dans une médiatisation permanente. Ces nouvelles plateformes offrent une tribune pour les athlètes, mais apportent aussi une certaine pression via l'accès direct aux sportifs pour leurs fans ou leurs détracteurs. Cette hyper-exposition rend la frontière entre vie publique et vie privée très difficile à gérer.
Les sponsors, quant à eux, sont devenus incontournables dans l'écosystème sportif.
Des calendriers surchargés
Même si elle paraît moins flagrante et directe depuis l’émergence des réseaux sociaux, la pression exercée par les médias traditionnels est loin de s’être évaporée et a toujours un réel impact sur le quotidien des athlètes.
Ces dernières années, de plus en plus de sports ont dû se plier aux accords de retransmissions sportives. Les différents diffuseurs sont prêts à tout pour réaliser un plus grand profit, quitte à négliger la santé mentale des athlètes.
En tennis, l’apparition de sessions nocturnes, plus communément appelées « Night sessions », a étiré les "journées" de matchs jusqu’aux premières lueurs du jour. Ce qui a pour effet de dérégler la routine du joueur de tennis.
En football, de plus en plus de joueurs se plaignent du nombre de matchs qui ne fait qu’augmenter. La recherche permanente de profit conduit à une hausse du nombre de compétitions, à des horaires toujours plus étendus.
"Il y a, sur les réseaux sociaux, un volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale"
Thierry Henry
- Ancien footballeur professionnel -
Critiques et insultes
L'évolution des médias et l’apparition des réseaux sociaux pèsent énormément sur le moral et la santé mentale des athlètes professionnels. Il est devenu difficile pour un sportif professionnel de ne pas se retrouver confronté aux critiques qui le visent. À force de voir de plus en plus de messages négatifs, le sportif peut se sentir submergé.
La pression qui se dégage des médias n’émane pas uniquement des réseaux sociaux. Cependant, il faut reconnaître que ces derniers sont devenus le premier vecteur de harcèlement envers les sportifs professionnels. Le nombre de messages virulents a drastiquement augmenté. Selon un rapport de la FIFA, plus de 50 % des joueurs ont été insultés lors de l'Euro 2020 de football.

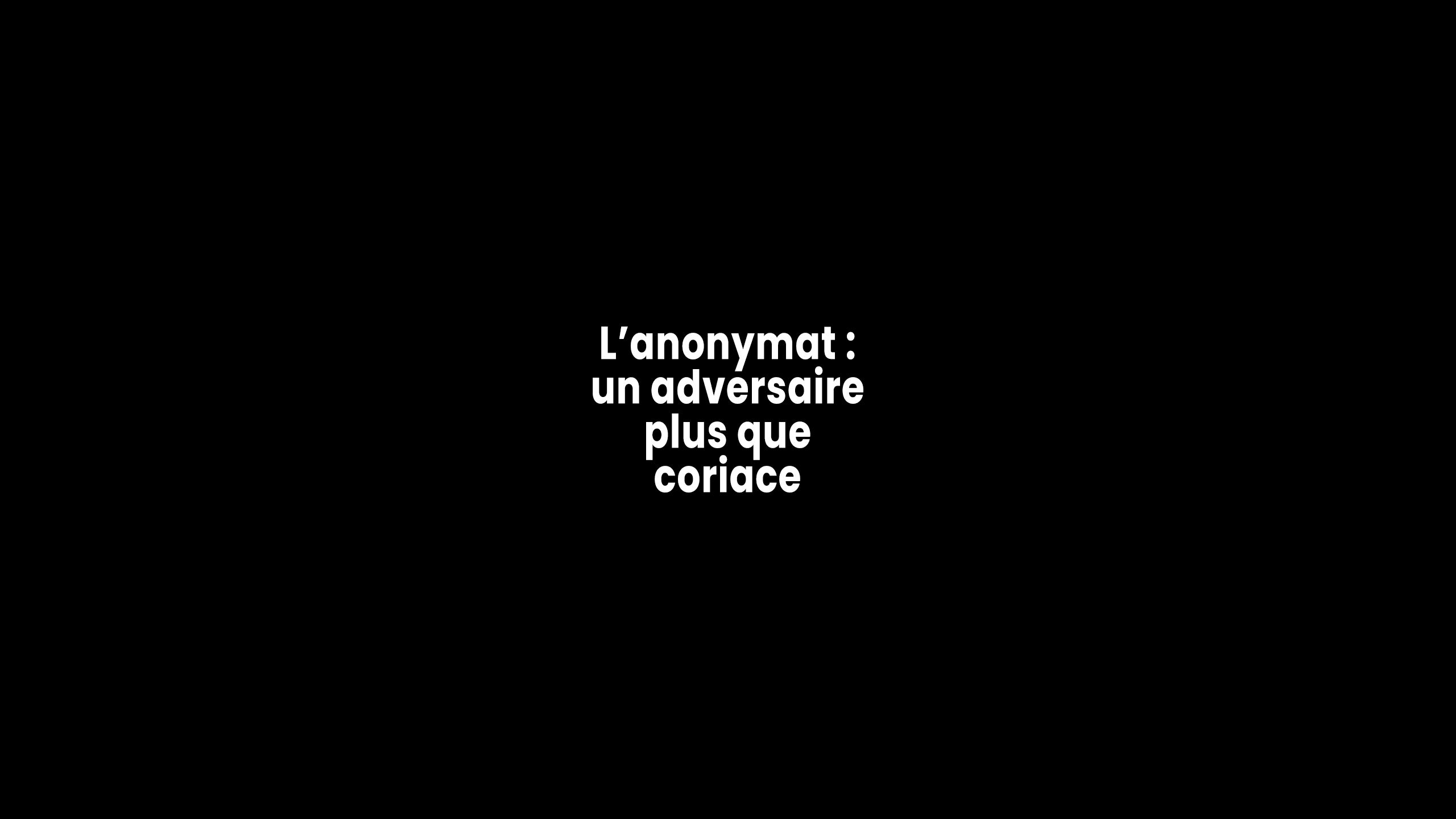
Benoit Paire, BW OPEN 2024, Emile Windal CC BY NC ND
Benoit Paire, BW OPEN 2024, Emile Windal CC BY NC ND
La plupart du temps, les auteurs de messages insultants, moqueurs, voire menaçants le font sous couvert d’anonymat. Ces adversaires sans visage sont presque impossibles à combattre pour les athlètes, qui n'ont pas d'énergie à dépenser dans une bataille de plus, face à un ennemi mal intentionné.
Cette haine gratuite peut se retrouver à différents endroits sur les réseaux sociaux. Qu'ils s'agissent de commentaires sur Instagram, X, Facebook, YouTube ou simplement des messages privés leur étant directement destinés, les athlètes en sont difficilement protégés. Leur exposition médiatique et le développement des moyens de communication font des athlètes des cibles facilement atteignables.
Ces dernières années, la montée en flèche de la popularité des paris sportifs a aussi influencé le nombre de messages de haine que peuvent recevoir les athlètes sur leurs différents réseaux.
Benoît Paire, tennisman français, a déjà dénoncé les messages d'insultes à plusieurs reprises. "C'est normal pour vous ?" avait-il partagé sur son compte X avec une capture d'écran affichant des messages de haine ou encore d'appels au suicide.
Les supporters, eux, représentent une autre forme de pression. Si leur soutien galvanise dans la majorité des cas, ils peuvent vite se retourner contre les sportifs qui les ont déçus. En cas d’échecs répétés, la ferveur a tendance à se transformer en huées et en commentaires insultants. Cela implique inévitablement une remise en question chez l’athlète concerné, voire le sentiment d’être délaissé.


